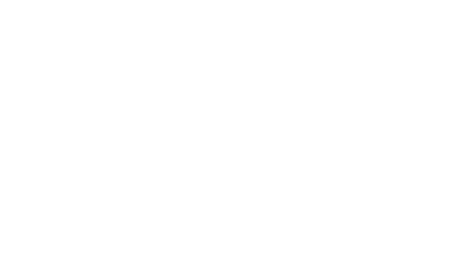Rapport Scientifique : Etude comparative des pratiques agricoles et leurs déterminants à Kinshasa


Les quartiers informels deviennent une option de logement pour une partie significative et croissante de la population urbaine de nombreux pays du monde entier. L’urbanisation rapide et la migration des zones rurales vers les villes sont des facteurs clés de l’augmentation des quartiers informels.

Le Népal, principalement agricole, a utilisé 227 836 tonnes de fertilisants chimiques en 2020/2021. L'utilisation excessive de pesticides est une préoccupation majeure en matière de santé au Népal malgré le programme appelé Integrated Pest Management (IPM).

Les deux recherches complémentaires présentées ici constituent une étude plus large visant à identifier les opportunités et les obstacles à la mise en place d’un réseau de santé de proximité en centre-ville de Metz en 2023.

La recherche dont les résultats sont exposés dans ce rapport avait pour objectif de comprendre les ressorts des problématiques de santé psychique de personnes exilées en situation de grande précarité à Paris, mais aussi ce qu’elles révèlent des politiques et des pratiques dites d’accueil, et, plus largement encore, ce qu’elles disent de l’hospitalité en ville.

Découvrez le nouveau Rapport de L'Observatoire de Médecins du Monde.

L’équipe de recherche remercie l’ensemble des personnes et institutions qui ont permis la réalisation de cette étude. Nous remercions tous les partenaires du centre de santé communautaire d’Assomin, de l’Hôpital général (HG) Houphouët Boigny d’Abobo, du laboratoire du centre anti-tuberculeux d’Abobo pour leur accueil sur les sites et tou·te·s les acteurs·trices ayant accepté de partager avec nous leurs expériences sur le projet cancer du col de l’utérus (CCU).

Merci à l’ensemble des participant·e·s pour leurs contributions et leurs témoignages ayant permis une analyse approfondie des difficultés d’accès aux droits de santé et aux soins rencontrées par les personnes en situation de précarité sur le territoire messin.

Nous remercions les 167 femmes et personnes LGBT mineur·es et majeur·es et les 29 parties prenantes qui ont généreusement donné de leur temps, qui ont répondu à des questions parfois sensibles, qui nous ont partagé leurs expériences, points de vue et visions, qui nous ont fait part de leurs suggestions pour réduire et faire face aux violences basées sur le genre dans le cadre du travail du sexe. Nous remercions les équipes de Médecins du Monde, sur terrain et au siège, des

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont bien voulu participer à cette étude, répondre aux sollicitations des chercheurs et faciliter leur travail sur le terrain.

Le cancer du col de l’utérus est, dans les pays à niveaux faible et intermédiaire de revenus, le cancer le plus fréquent et la principale cause de mortalité par cancer chez la femme. Au Burkina Faso, le cancer du col est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes.

Cette année, le 5e rapport annuel de l’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels (squats, bidonvilles et campements) a recensé 1 111 expulsions sur le territoire national, dont 729 pour le littoral nord, chaque lieu de vie représentant en moyenne 130 personnes.

Destinée à couvrir les soins de santé des personnes sans titre de séjour, l’Aide médicale d’Etat (AME) fait l’objet d’attaques récurrentes au Parlement, et aujourd’hui au sein même du gouvernement. Elle nourrit des fantasmes aux antipodes de la réalité du terrain observée par les équipes de Médecins du Monde en France.

La partie sud de Madagascar a souffert d’un fort épisode de sécheresse entre 2020 et 2022, entrainant une dégradation sévère de la situation alimentaire et économique des populations. De nombreuses études menées dans le Sud ont mis en avant une forte prévalence des violences basées sur le genre (VBG) dans les communautés.

Les personnes en situation de précarité sont les premières touchées par la crise du système de santé en France. Les inégalités de santé se creusent et sont renforcées par des accès aux droits et aux soins discriminatoires. C’est le constat que tire Médecins du Monde de son 22ème rapport annuel de l’observatoire de l’accès aux droits et aux soins des plus démunis en France, qui sort ce jeudi 8 décembre.

La présente recherche a été conçue par Médecins du Monde France (délégation des Pays de la Loire, Direction Santé et Plaidoyer, Direction des Opérations France) en collaboration avec le CHU de Nantes et plus précisément avec l’Unité Gynécologie-Obstétrique Médico-Psycho-Sociale (UGOMPS), l’unité de Santé Publique Interventionnelle (SPIn) et le Service de suites de couches de la maternité. Cette recherche vise à étudier les représentations sur la santé, ainsi que la description de la perception de l’impact de l’environnement sur la santé, des femmes enceintes ou ayant récemment accouché vivant en habitats instables, informels, indignes et/ou insalubres (habitats 4i). De nombreuses études explorent l’impact des lieux de vie 4i sur la santé, toutefois en ciblant des pathologies en particulier, des dimensions restreintes de la santé, ou des habitats 4i spécifiques. En revanche, cette étude a pris en compte plusieurs déterminants de la santé reliés aux lieux de vie 4i, ainsi que la perception de leur impact sur l’ensemble des dimensions de la santé (physique, mentale, et sociale), afin de pouvoir étudier ce phénomène dans sa globalité et dans sa complexité. Cette démarche participative est fondamentale pour pouvoir proposer des solutions qui soient capables de respecter les attentes, les priorités, et les besoins des personnes directement concernées.
Témoigner pour dénoncer,
informer pour engager